Le fonds de Marina Decarro est désormais décrit et consultable aux Archives contestataires. Il retrace les luttes féministes auxquelles elle a participé, entre les années 1980 en 2010. Ce carnet présente trois moments significatifs de la période, encore peu étudiée : la lutte pour l’assurance maternité, la création de la coalition féministe FemCo et la campagne pour le droit à l’avortement. Tous les documents reproduits ici proviennent du fonds.
La lutte pour l'assurance-maternité
« En 1945, les citoyens suisses ont accepté une modification de la Constitution prévoyant l’institution d’une assurance-maternité. 50 ans plus tard, nous attendons toujours la mise en application de ce mandat constitutionnel. » C’est par ces mots que le Comité en gestation donne le ton de la campagne pour une véritable assurance-maternité : les femmes en ont assez d’attendre ! Deux ans après la grève des femmes de 1991, à laquelle 500'000 femmes ont participé, de nombreuses féministes et syndicalistes suisses – majoritairement romandes – fondent le Comité en gestation et s’unissent pour revendiquer une véritable protection de la maternité.
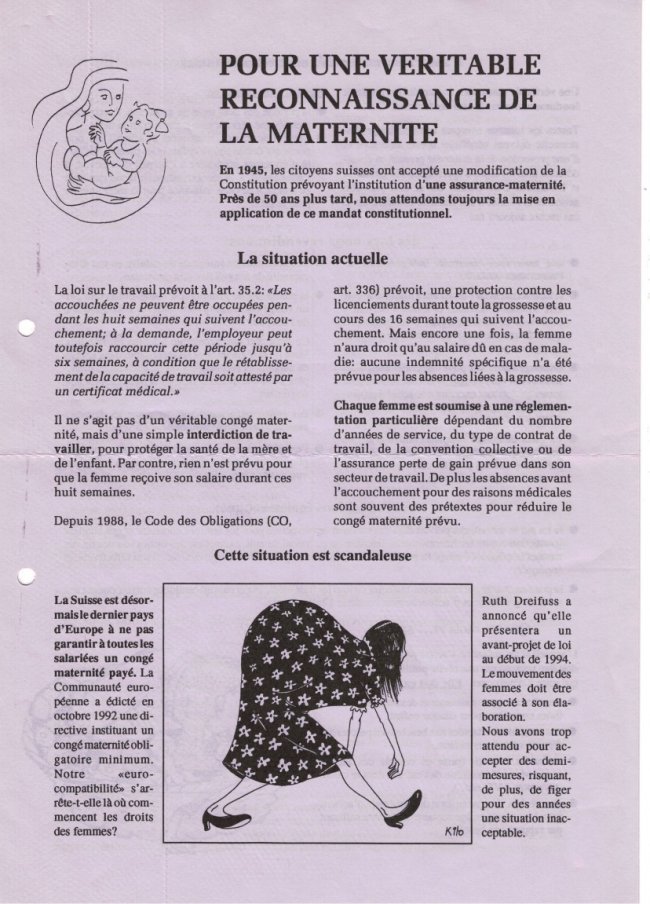 |
|---|
| Manifeste pour une véritable assurance maternité |
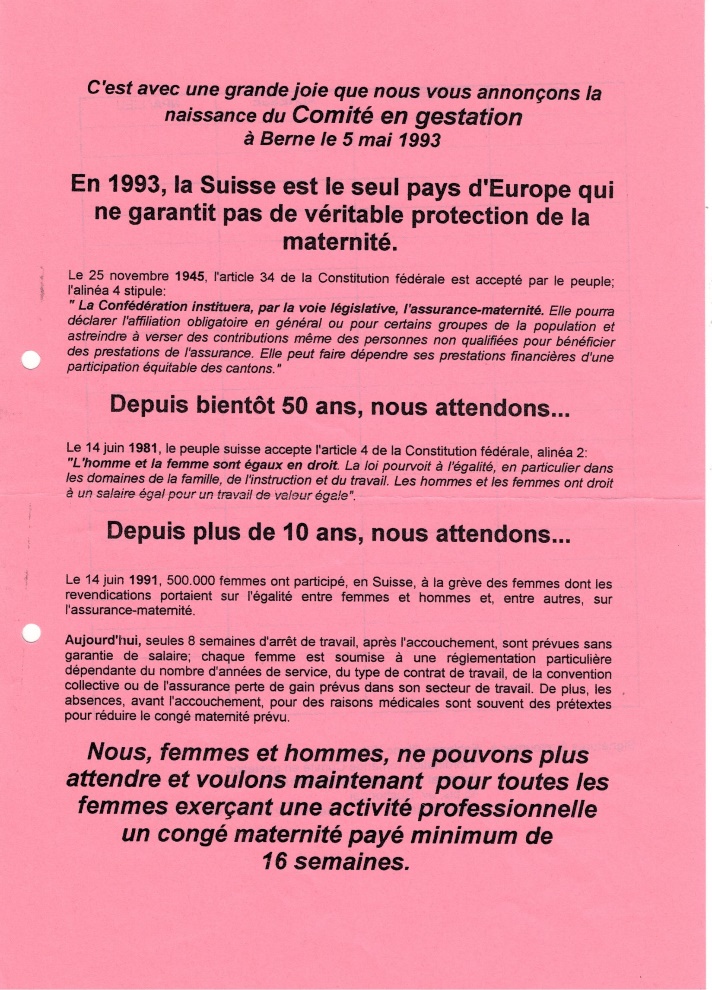 |
|---|
| Annonce de la création du Comité en gestation |
Pendant plusieurs années, la campagne progresse, avec des manifestations, des prises de position, des dialogues avec les sphères politiciennes, mais aussi avec l’organisation de « la grande lessive », exposition itinérante pour promouvoir l’assurance-maternité, qui se promène dans toute la Suisse.

 |
|---|
| Photographies de l’inauguration de l’exposition « La grande lessive » sur la Plaine de Plainpalais |
Malgré tous les efforts fournis, le 13 juin 1999, la votation fédérale sur l’assurance-maternité se solde par un cuisant échec pour le mouvement féministe suisse : après une campagne effrénée, le corps électoral choisit le « non » à 61%. En plus de creuser l’écart entre les féministes romandes et alémaniques, cette défaite provoque une crise dans le mouvement syndical et une profonde remise en question de la forme et du contenu de la campagne.
| Courrier à l’USS de la part des femmes engagées dans la campagne pour une véritable assurance maternité |
Tout n’est cependant pas perdu : lors de cette votation fédérale, le corps électoral genevois dit « oui » à 74,3%, ce qui donne au comité genevois une légitimité pour exiger une assurance-maternité cantonale. Le projet qui aboutit est une proposition « patronale ». Après moult aller-retours parlementaires, cette dernière entre finalement en vigueur le 1er juillet 2001.
Pas le temps de souffler : les comités en gestation romands repartent à la charge pour obtenir une assurance-maternité fédérale. Insatisfaites par un avant-projet au niveau fédéral concernant une révision du code des obligations, les féministes continuent de revendiquer un congé de 16 semaines avec une assurance qui couvre la perte de gain à 100%. Le 26 septembre 2004, les votant·es suisses sont appelé·es à se prononcer sur la révision du régime des allocations pour perte de gain (APG), qui contient entre autres une assurance-maternité de 4 semaines. Cette fois, l’assurance-maternité est acceptée ! Mais un doute subsiste au niveau genevois : la loi fédérale étant moins ambitieuse que la loi genevoise (au niveau du nombre de semaines de congé, de l’inclusion de l’adoption et du montant des indemnités), les acquis cantonaux vont-ils être remis en question ? Après des débats, il n’en est finalement rien, et Genève conserve son assurance-maternité plus avantageuse pour les mères.
Consulter la série « Assurance-maternité » dans l'inventaire du fonds Marina Decarro.
La création de la FemCo
En décembre 1996, l’OFRA (l'Organisation pour la cause des femmes ou Organisation für die Sache der Frau) fait le constat qu’elle est en perte de vitesse et qu’un changement structurel s’impose. Elle propose de créer une « nouvelle OFRA » qui se comprendrait comme une « coalition féministe nationale ». C’est ainsi que naît le projet de la FemCo (Coalition Féministe/Feministische Koalition), qui est fondée le 31 octobre 1998, après une longue période de consultation et de construction de la structure entre différents groupes féministes.
 |
|---|
| Communiqué de presse de la FemCo lors de sa fondation |
La FemCo se présente comme un « regroupement national de projets, de groupes, d’organisations de femmes, ainsi que d’individues », qui vise à « dynamiser, informer, faire office de plaque tournante tant à l’intérieur du mouvement féministe que vis-à-vis de l’extérieur ». Elle souhaite notamment avoir un rôle de soutien et de coordination pour différents projets féministes, faire du lobby auprès des instances politiques, et poursuivre les débats féministes.
La FemCo se mobilise en faveur de l’assurance-maternité et, comme le reste du mouvement féministe, est secouée par l’échec de la votation de juin 1999.
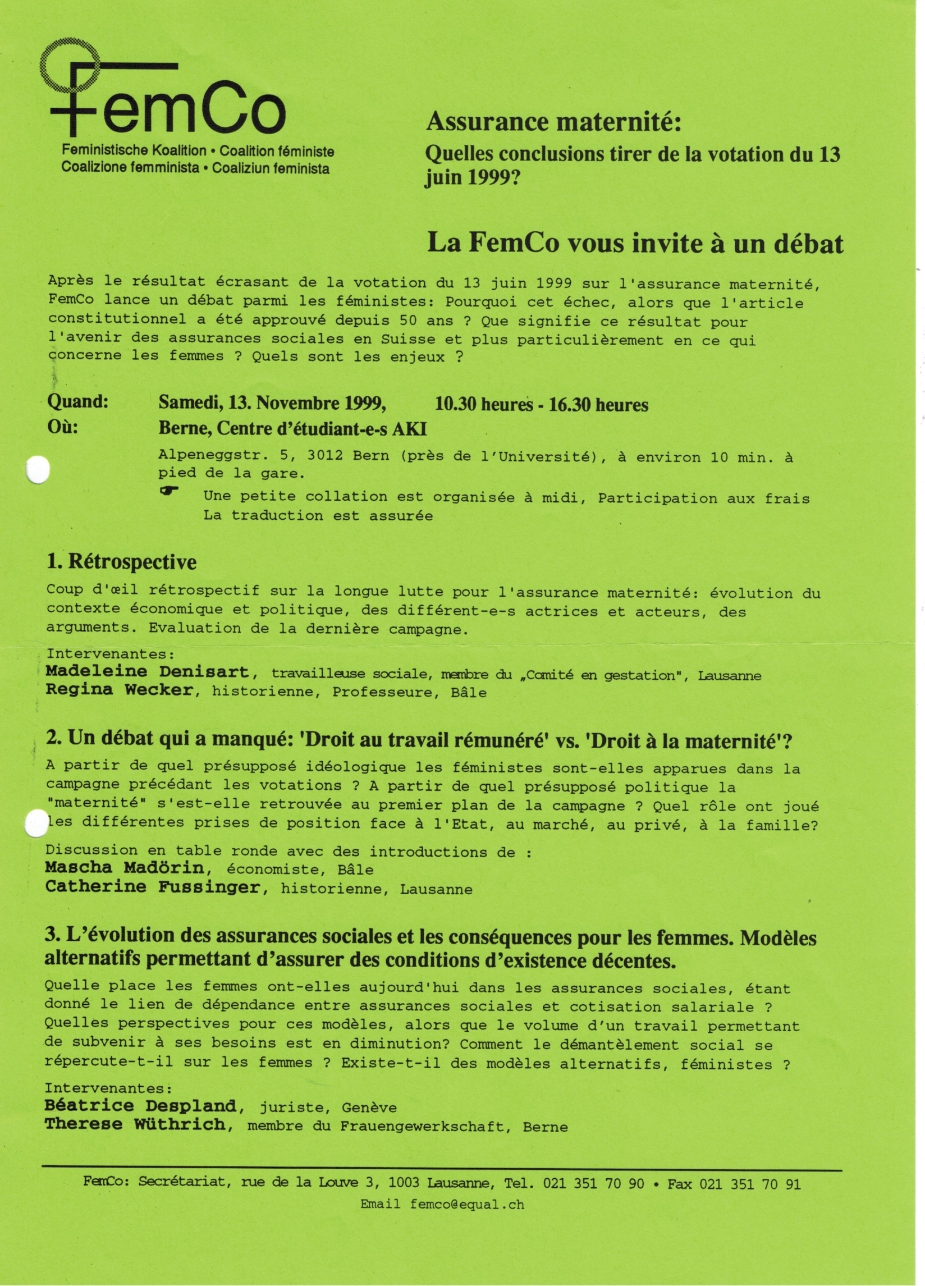 |
|---|
| Invitation au débat organisé par la FemCo suite à l’échec de la votation sur l’assurance maternité |
Les années qui suivent, la FemCo se mobilise sur des questions telles que l’avortement, l’AVS ou encore les femmes migrantes sans statut légal. Mais autour de 2007, elle doit admettre que ses forces diminuent : peu de femmes participent aux forums, les membres se font de plus en plus rares et les initiatives manquent. Soucieuse de maintenir un réseau féministe fort et efficace, la FemCo amorce un rapprochement avec la Marche Mondiale des Femmes. En effet, les membres actives de la FemCo sont pour la plupart également engagées dans la Marche Mondiale des Femmes, qui pour sa part manque de moyens financiers et de continuité dans le temps. Les deux structures décident donc de mettre leurs forces en commun et la FemCo s’éteint.
Consulter la série « FemCo » dans l'inventaire du fonds Marina Decarro.
La campagne pour le droit à l’avortement
Jusqu’en 2002, le cadre juridique suisse encadrant l’avortement est très restrictif, malgré une pratique de plus en plus libérale. Cet écart entre loi et pratiques permet dans les fait d’avorter partout en Suisse, mais avec des obstacles plus ou moins grands selon les régions. Cela débouche sur une inégalité de fait entre les cantons et entraine ce qu’on peut qualifier de « tourisme gynécologique ».
La lutte pour la dépénalisation de l’avortement en Suisse a duré 30 ans : en 1971, une première initiative n’aboutit pas. Elle est suivie en 1977 par une première proposition de « solution du délai » (c’est-à-dire qui permet l’avortement jusqu’à un certain délai), qui est refusée lors d’une votation. Le contre-projet rétrograde du Conseil Fédéral est également rejeté, grâce à la mobilisation de plusieurs comités qui s’uniront en 1979 en une association : l’ASDAC (Association Suisse pour le Droit à l’Avortement et à la Contraception).
  |
|---|
| Prospectus de présentation de l’ASDAC |
En 1993, la conseillère nationale socialiste Barbara Haering-Binder lance une initiative parlementaire pour une solution du délai. Après les allers-retours usuels entre les chambres fédérales, et suite à un important lobby, notamment de la part de l’ASDAC, du Groupe de travail « Interruption de grossesse » et de l’Union Suisse pour Décriminaliser l’Avortement (UPSDA), le parlement adopte finalement en 2001 un projet de loi dépénalisant l’avortement. Il s’agit d’une modification du Code pénal suisse, qui permet l’avortement dans les 12 semaines, avec plusieurs conditions : les femmes voulant avorter doivent adresser une demande écrite à leur médecin, faire état d’une situation de détresse, et subir un entretien obligatoire durant lequel elles se voient remettre un dossier d’informations.
Mais la bataille n’est pas finie : la proposition de loi sera soumise au vote. Un référendum est annoncé par les milieux conservateurs anti-choix, bientôt rejoints par l’UDC et la frange conservatrice du PDC. Ils déposent l’initiative dite « Pour la mère et l’enfant » qui propose d’interdire l’IVG, sauf en cas de danger pour la vie de la mère. Cette initiative représente un risque d’immense retour en arrière, d’où le slogan des féministes qui font campagne pour le droit à l’avortement : « un pas en avant ou cent pas en arrière ».
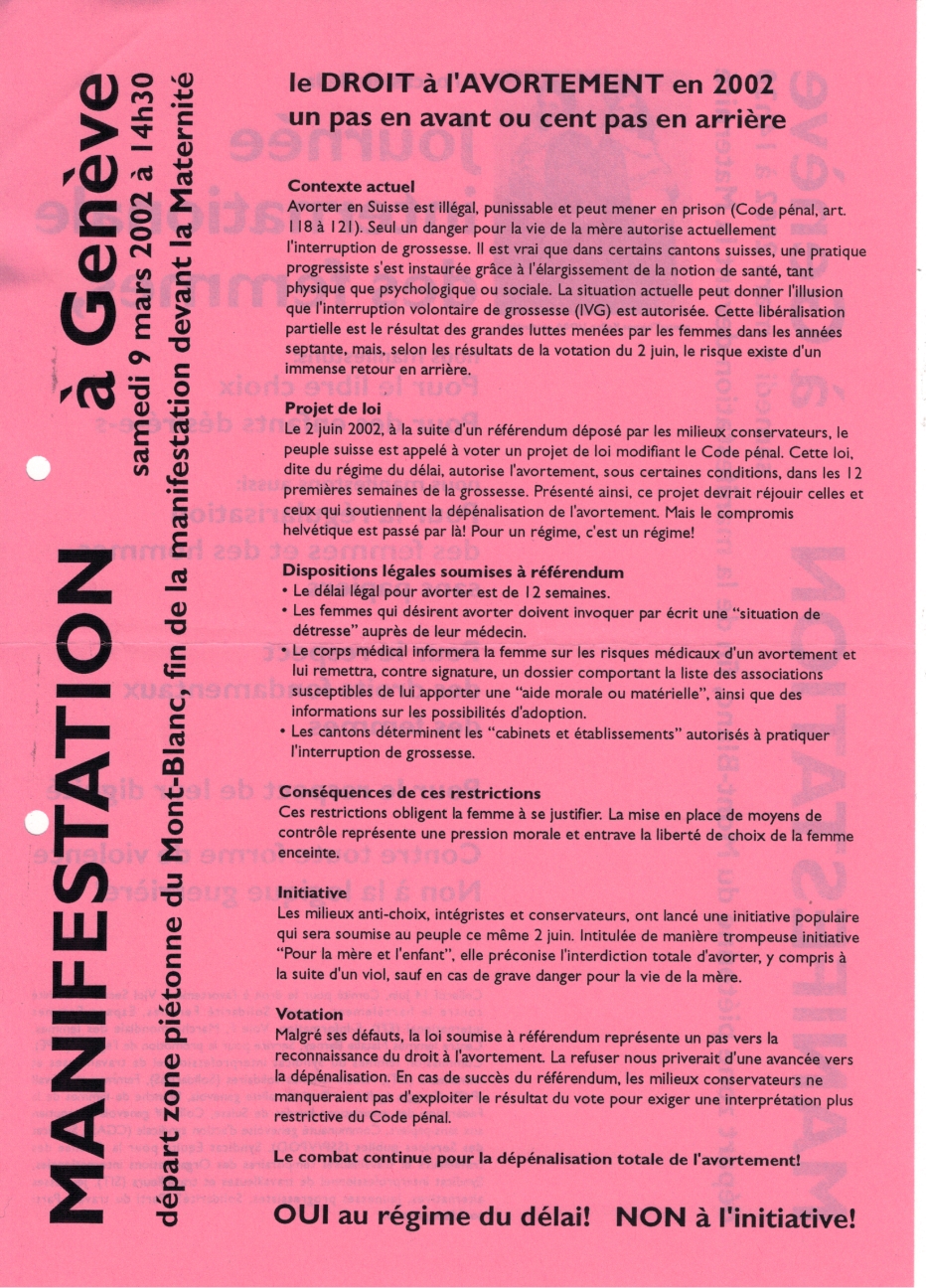 |
|---|
| Appel à manifester le 9 mars 2002 en faveur de l’avortement |
Elles s’organisent, notamment en investissant les courriers des lecteurs et lectrices dans la presse pour rétablir les faits face à la campagne mensongère et démagogue des milieux anti-avortement, qui prétendent que le « régime du délai » autoriserait l’avortement jusqu’à la naissance. Leurs affiches de campagne jouent sur le sensationnel et l’émotion en mettant en scène des monstres dévorant des enfants, un fœtus nommé Julie qui dit qu’on ne supprime pas ceux qu’on aime, ou encore une femme qui déclare être heureuse d’être en vie même si elle est le fruit d’un viol.
La mobilisation se poursuit avec vigueur jusqu’à la votation fédérale du 2 juin 2002, où les votant·es disent finalement « oui » au régime du délai. La loi entérine les pratiques progressistes de certains cantons et les étend aux parties plus conservatrices de la Suisse. Toutefois, la solution n’est pas parfaite : en plus d’être régit par le Code pénal, la possibilité d’avorter devient liée à la notion de « détresse ». Les féministes critiquent donc une infantilisation des femmes qui devront encore justifier leur volonté d’interrompre leur grossesse. Cette votation représente, après 30 ans de travail, une victoire retentissante pour les féministes.
Consulter la série « Avortement » dans l'inventaire du fonds Marina Decarro.
 |
|---|
| Photo de la manifestation du 9 mars 2002 pour l’avortement |
Les publications provenant des archives de Marina Decarro ont été intégrées au catalogue de bibliothèque. La liste se trouve ici (catalogage encore en cours).
Les références bibliographiques consultées pour rédiger cet article sont les suivantes :
